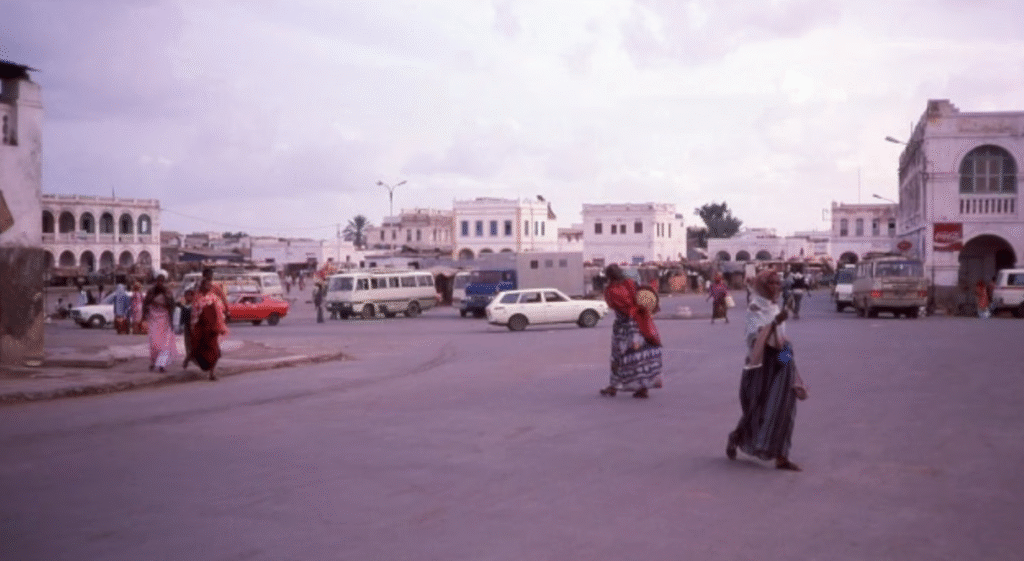
La République de Djibouti vient de célébrer son 48ème anniversaire d’indépendance. A peine eût-il sorti de l’euphorie de ce qu’on appelle la libération nationale, le peuple a dû déchanter sur tous les plans. Dans le cadre de cet article, nous ne traiterons que brièvement l’aspect politique.
Au joug colonial s’est substituée un régime dictatorial caractérisé par le régime de parti unique (RPP, 1981) et la répression de toute opposition politique. La principale menace émanait des hommes qui étaient censés veiller au bonheur de leurs concitoyens. D’où la difficile prise de conscience continuant à fermenter depuis 48 ans !
Une lente descente en enfer (1977-1990)
Premier signe de la désillusion, la démission d’Ahmed Dini, en décembre 1977, a sonné le glas d’une réconciliation nationale. Six mois ont suffi pour faire voler en éclat le pacte tacite. En effet, le duo Hassan Gouled (Président de la République) et Ahmed Dini (Premier ministre), à la tête du pays, était censés incarner la concorde nationale entre les deux principales ethnies du pays, à savoir les Afar et les Somali. Les tensions de l’année 1976, au cours de laquelle de militants de la LPAI avaient massacré des familles Afar dans les Quartiers 1 et 2, étaient oubliées. Par conséquent, la mission de deux vétérans de la vie politique djiboutienne était de conjurer la division qui avait fait tant de mal au pays durant l’administration coloniale.
N’ayons pas peur de mots. En réalité, le rêve de liberté et de progrès caressé un instant par le peuple djiboutien relevait de l’utopie. L’indépendance s’avérait une amère illusion. Car, omniprésente dans ses anciens territoires d’outre-mer, l’ancienne puissance de tutelle tirait les ficelles. Elle chuchotait aux oreilles de la nouvelle classe dirigeante. Pas si nouvelle que ça au vu de leur carrière passée. Il fut aisé de leur fabriquer une nouvelle virginité. Aussi des dizaines d’Hassan Gouled et autres politiciens véreux, indépendantistes de la 25 ème heure, se bousculaient au portillon pour se mouler dans l’habit de « président » ou de « ministre » conciliants. Tous prêts à écouter la voix de leur maître et céder à tous ses caprices et intérêts. Pour briguer ces fonctions, leur curriculum vitae (cv) devait présenter quelques exigences minimales sous forme des trois A : Analphabètes, Antinationalistes et Appât de gains.
Le reste ne fut qu’une simple formalité. Il ne leur restait plus qu’à suivre la feuille de route rédigée par Paris. Elle impliquait la mise à jour de la politique de « diviser pour régner », un principe qui avait tant de fois fait ses preuves dans la gestion des territoires colonisés. La preuve par mille : maintes fois, sous de prétextes et rivalités fallacieux alimentés par l’administration, les Djiboutiens n’avaient pas hésité à s’entretuer (Guerre civile entre Issa et Gadaboursi en 1949).
Cette fois-ci, suprême passe-passe, les rênes du pouvoir semblaient être entre les mains des dirigeants autochtones. Tout donnait l’impression que la France n’y était pour rien. Et, préalablement conditionné par plus d’un siècle d’aliénation (1884-1977), et travaillé par le tribalisme, le peuple djiboutien n’y a vu que du feu. Depuis, le poison de la division n’a cessé de ravager notre société. Passant de nationalisme (1977) au tribalisme (1977-1990), du tribalisme au clanisme (1991-2000), le dogme a changé mais la pratique est restée la même. Le népotisme et la corruption étant les maîtres-mots de la politique menée par le régime.

Le mirage du tribalisme Issa
En 1977, les plus excités parmi les Somali vantaient la naissance d’un nouvel Etat « Somali », censé rejoindre la République de Somalie voisine. Le rêve inabouti de Mahmoud Hrabi, l’ancien vice-président du Conseil de gouvernement (1958-1960), semblait à deux pas de retrouver son couronnement. D’autres, plus clairvoyants mais tout aussi naïfs, comprenaient les artistes qui avaient tant fait pour célébrer les bienfaits de l’émancipation nationale. Mais, enivrés par le délire tribal, ils appelaient maintenant à la création d’un « Etat Issa ». Encore un rêve impossible. La réalité ethnique (Afar, Arabe et Somali) et la configuration sociologique (population de plus en plus éduquée) de Djibouti remettaient en question de telle élucubration.
La lente érosion du « nationalisme » Issa
Aujourd’hui, après 48 ans d’assassinats et tortures de civiles et une guerre civile (1990-1994) ayant causé la mort de plus 1500 Djiboutiens, les liens de solidarité tribale se délitent sous le coup asséné par des intellectuels Somali, toutes origines tribales confondues. Le crédo du « Cer Issa, le verdict de l’arbre », sublimé par un ouvrage idéologique qui servait de guide aux partisans de la dictature, a atteint ses limites. Publié en 1988 par Ali Moussa Iyé, ce « livre vert » était destiné à mobiliser et guider la communauté Issa vers la consécration étatique. A cette fin, les Issa étaient appelés à se créer une nouvelle identité. La tribu se voulait « ethnie », « nationalité », en concurrence directe avec le terme « Somali ». De plus, en matière de promotion médiatique cher payée, la dictature pouvait compter sur « Jeune Afrique » magazine écrivant sans vergogne « Les Afar et les Issa, les deux principales ethnies djiboutiennes… »
Les Issa ont contribué à asseoir la dictature Mamasan
Suprême ironie d’une divagation collective, toutes ces manœuvres ont abouti à un résultat inattendu : la consolidation d’une autocratie. Grâce à un passe-passe étourdissant qui a berné tous les clans et sous-clans Issa, le clan Mammaasan s’était emparé de tous les rênes du pouvoir. Le coup d’Etat avorté du général Yacin Yabbe Galab, en décembre 2001, fut à la fois la manifestation d’une déception et le chant du cygne du « nationalisme » Issa. Il faut dire que les Fourlaba, au côté des Odahgob, avaient tenu le rôle de seconds couteaux (policiers, militaires et gendarmes) dans la répression menée contre leurs concitoyens Afar.
Le désaveu de la politique tribale (2011)
Quoique fasse la dictature Mamasan, le désaveu de la dictature est largement partagé, à partir de 2011, par la majorité de Djiboutiens. Le rejet du régime obéit à une tendance lourde comme celle qu’on a observée au Rwanda au début des années 90. Lorsque l’opposition, composée de Hutu modérés, avait massivement dénoncé la dictature du président Habyarimana, prétendument présentée comme un système favorisant l’ethnie Hutu, alors que le système pervers ne profitait qu’à une poignée d’oligarques proche du chef de l’Etat.
Dans le scénario en cours à Djibouti, l’activisme des nationalistes Afar et Arabe, bien que nécessaires, apparait superfétatoire. Mais il n’en est rien pour l’instant. Il faut maintenir la pression sur l’Etat et ses partisans.
Il est vrai qu’en matière de solidarité tribale, le régime, affaibli, puise ses ultimes réserves dans l’immigration des membres de la tribu Issa en provenance d’Ethiopie et de Somaliland. Depuis 2011-2012, le phénomène s’est accéléré en parallèle avec le désaveu décrit ci-dessus. Trois processus permettent de l’illustrer :
- la « somalisation » de l’administration et des corps de l’Armée, de la Police et de la Marine ; (les Afar ne représentent plus que 15 à 20%, alors qu’en 1977, leur pourcentage était proche de 40 à 45%, 5% pour les Arabe) ;
- la création de la région Arta ; (Elle est supposée être une région administrative « Issa ») ;
- et l’installation à Bakerré, région Dikhil, des milliers de familles Issa ; (Ce qui participe à la politique de conquête territoriale. Le régime ne comprend pas que ce processus continu a pour effet de remettre à l’ordre du jour la question de « naturalisation » !)
Vers une guerre civile inévitable ?
La situation est explosive. Si le régime s’effondre, le scénario d’une guerre civile paraît inévitable. L’opposition djiboutienne doit s’y préparer lucidement.
Ali Coubba (né en 1961 à Tadjoura, Djibouti) est docteur en Histoire contemporaine et écrivain. Spécialiste de la Corne de l’Afrique, il est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence publiés chez L’Harmattan, notamment Djibouti : une nation en otage (1993), Le mal djiboutien : rivalités ethniques et enjeux politiques (1995), ou encore Ahmed Dini et la vie politique à Djibouti (1998). Exilé en France depuis 1990, il poursuit son engagement politique en créant en 2004 le mouvement d’opposition Uguta‑Toosa (« Levez‑vous ! Défendez‑vous ! ») et enseigne dans un lycée professionnel à Épernay, tout en continuant d’écrire et d’analyser la situation politique de son pays d’origine





