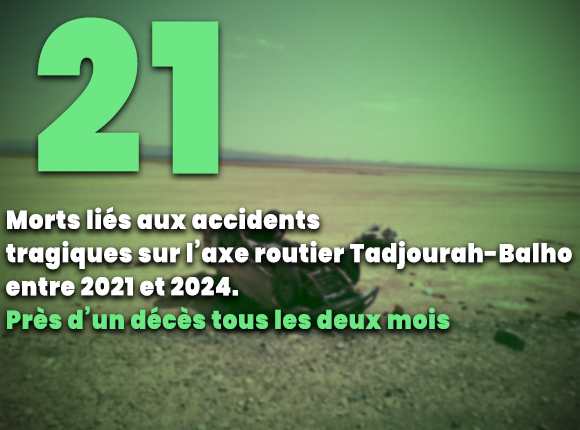Une déclaration qui secoue les lignes
Lors d’une conférence tenue récemment en Éthiopie, le RSADO (Red Sea Afar Democratic Organization), épaulé par plusieurs figures de la diaspora afar érythréenne et des autorités coutumières en exil, a franchi un cap symbolique et politique : revendiquer officiellement le droit à l’autodétermination, incluant la sécession, pour le peuple Afar d’Érythrée. Ce qui pouvait hier encore relever du tabou ou de l’implicite est désormais énoncé sans détour. Si cette posture peut sembler en rupture avec l’orthodoxie diplomatique et les logiques de souveraineté étatique, elle n’est ni arbitraire ni fantaisiste. Elle s’appuie sur une architecture juridique internationale, sur une mécanique d’oppression systémique à l’intérieur de l’Érythrée, et sur des précédents historiques qui donnent à cette exigence non seulement une légitimité certaine, mais aussi une faisabilité politique qui mérite d’être interrogée.
À cette annonce, une question s’impose : cette revendication est-elle juridiquement fondée ou politiquement utopique ? Et surtout, l’Érythrée, dont la propre naissance fut le fruit du même droit à l’autodétermination, peut-elle en toute cohérence contester cette revendication afar ?
Le droit à l’autodétermination : entre mythe et norme juridique
En droit international, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est consacré. On le retrouve à l’article 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), et dans la Charte des Nations unies (article 1.2). Ce droit a notamment servi de fondement à la décolonisation au XXe siècle. Mais s’agit-il d’un droit applicable dans des contextes postcoloniaux comme celui des Afars érythréens ?
La réponse est moins évidente. Selon le juriste Antonio Cassese, l’autodétermination est un principe évolutif, dont l’application est conditionnée à certaines circonstances : oppression persistante, exclusion systémique d’un groupe ethnique ou linguistique, impossibilité manifeste de participation politique. C’est précisément sur ces critères que le RSADO fonde sa demande.
Le mouvement pointe les discriminations ciblées subies par les Afars d’Érythrée : marginalisation politique, dépossession de terres, militarisation des zones habitées, persécutions religieuses et culturelles, et plus récemment, expulsions forcées au profit d’intérêts économiques liés au régime. Dans ce cadre, l’appel à l’autodétermination se veut une riposte juridique à un processus de dépossession et de négation identitaire.

La jurisprudence internationale : un précédent pour les Afars ?
Le précédent le plus éclairant demeure celui… de l’Érythrée elle-même. Longtemps province de l’Éthiopie, annexée en 1962, elle a mené une guerre de trente ans, avant que le référendum d’indépendance de 1993, supervisé par l’ONU, n’aboutisse à la naissance d’un nouvel État. Le principal argument des indépendantistes érythréens ? Le droit à l’autodétermination face à la répression et à l’assimilation forcée.
Difficile pour Asmara de rejeter une logique qu’elle a elle-même invoquée avec succès. Si l’on applique les mêmes critères aux Afars d’Érythrée – minorité culturelle et linguistique, vivant dans une zone frontalière et stratégique, exclue des centres de pouvoir – l’analogie est troublante. Le miroir devient accusateur : en niant le droit des Afars, le régime d’Isaias Afwerki s’érige contre les principes qui ont fondé sa propre légitimité.
D’autres cas nourrissent cette réflexion. En Kosovo, la Cour internationale de justice (CIJ) a jugé en 2010 que la déclaration unilatérale d’indépendance n’était pas contraire au droit international. Sans créer un droit à la sécession, cet avis ouvre une brèche : lorsqu’un groupe subit une oppression grave et prolongée, la communauté internationale peut reconnaître la légitimité de sa revendication.
Sécession, autonomie, ou fédéralisme ? Les chemins étroits de la légitimité
Toutefois, revendiquer n’est pas obtenir. Le droit international tolère la sécession dans des cas extrêmes, mais ne l’encourage pas. La doctrine majoritaire, exprimée par des auteurs comme Alain Pellet ou James Crawford, estime que l’intégrité territoriale des États prime, sauf si le groupe concerné est victime de violations massives des droits humains, sans autre recours possible.
Dans le cas afar, la difficulté vient du manque de reconnaissance formelle par des institutions internationales. Le RSADO est un acteur encore marginal, sans légitimité démocratique claire, ni administration en exil fonctionnelle. Le soutien de l’Éthiopie, qui héberge ses bases militaires, soulève par ailleurs des soupçons d’instrumentalisation régionale, dans un contexte de tensions persistantes avec Asmara.
Dès lors, la piste la plus réaliste à court terme semble être celle d’une reconnaissance des droits collectifs, d’une autonomie régionale élargie, ou d’un statut fédéral – plutôt qu’une indépendance pleine et entière. Mais cela supposerait un changement radical dans la structure politique érythréenne, actuellement verrouillée par un régime autoritaire qui refuse toute réforme.
Conclusion : l’utopie, arme des sans-voix ?
Alors que le RSADO transforme sa rhétorique en stratégie politique, son combat interroge sur ce que le droit peut offrir à ceux que les États abandonnent. En réclamant l’autodétermination, les Afars d’Érythrée ne demandent pas nécessairement une indépendance immédiate, mais affirment un droit fondamental : celui d’exister politiquement, dans un pays qui les nie.
Dans un monde où l’autodétermination reste à géométrie variable – tolérée au Kosovo, étouffée en Catalogne, niée en Palestine – le cas afar renvoie à cette zone grise du droit international, où la légitimité morale peut précéder la reconnaissance juridique. Utopie ? Peut-être. Mais l’histoire enseigne que les utopies des peuples opprimés sont souvent les prémices des géographies futures.