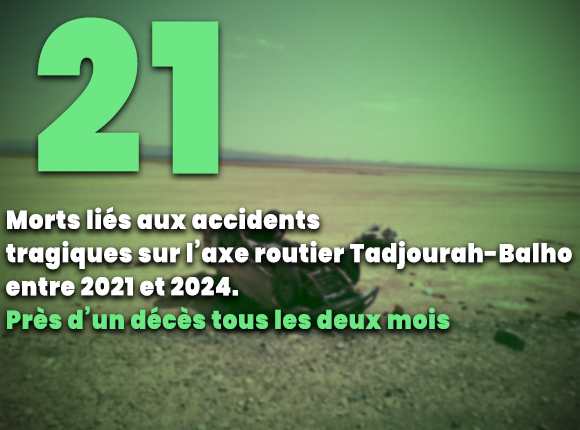À Djibouti, un paradoxe saute aux yeux de l’observateur attentif. Lorsqu’un Afar accède à une fonction publique, fût-elle subalterne, l’événement est relayé d’épopée avec éclat sur les réseaux sociaux : photos, hommages, déclarations de fierté se multiplient, transformant la nomination en victoire collective. À l’inverse, lorsqu’une autre communauté, notamment les somalis, obtient un poste, la nouvelle passe souvent inaperçue, accueillie au mieux dans l’indifférence, au pire par de nouvelles revendications.
Ce contraste, loin d’être un simple détail sociologique, éclaire deux rapports radicalement différents à l’État. Il met en évidence la manière dont histoire coloniale, inégalités structurelles et « politique de la reconnaissance » se croisent et produisent des subjectivités collectives distinctes. Axel Honneth, dans La lutte pour la reconnaissance (1992), a montré que les communautés marginalisées développent une hypersensibilité à tout signe de validation, car celui-ci opère comme une réparation éphémère, certes, mais indispensable d’une blessure identitaire profonde. C’est précisément le cas des Afars : chaque nomination, chaque projet est interprété comme une réaffirmation de leur existence politique. D’où l’intensité des célébrations : ce qui ailleurs relèverait de la routine administrative devient, pour eux, un événement historique.
On retrouve ici ce que les sciences sociales appellent la « psychologie de la rareté » : ce qui est rare acquiert une valeur disproportionnée. Chez les Afars, la rareté de l’accès au pouvoir confère à chaque geste de l’État une dimension presque sacrée. À l’inverse, pour les somaliens, majoritaires dans l’appareil étatique, l’accès aux fonctions est perçu comme allant de soi. Ce qui domine ne se célèbre pas : il se réclame toujours davantage. Là encore, Bourdieu nous fournit une grille de lecture éclairante avec le concept de « domination symbolique » : les dominants imposent une norme qui invisibilise leurs privilèges, tandis que les dominés s’habituent à vivre dans l’exception, parfois jusqu’à intérioriser leur propre marginalisation.
Cette dynamique n’est pas sans conséquence politique. En magnifiant de petites concessions comme des victoires décisives, les Afars risquent d’entretenir leur propre marginalité. Car si le minimum déclenche déjà le maximum de gratitude, pourquoi l’État irait-il plus loin ? Le pouvoir central peut distribuer, avec parcimonie, quelques postes ou projets régionaux sans jamais remettre en cause le déséquilibre structurel. Ce que Honneth décrit comme une « quête de reconnaissance » devient alors un piège de l’accommodement : l’insuffisant, valorisé à outrance, finit par renforcer l’ordre établi.
Les réseaux sociaux ne se contentent pas de refléter ce clivage : ils le grossissent, l’exacerbent et lui confèrent une résonance publique. Les élites et cadres afars y trouvent un théâtre où mettre en scène leur prétendue utilité publique L’inauguration d’un projet, fût-il derisoire – la remise de quelques équipements, une visite protocolaire sans portée réelle – est relayée avec emphase, enveloppée de discours laudateurs. La fonction politique n’y est plus jugée à l’aune de ses réalisations concrètes, mais à travers le spectacle symbolique de sa visibilité. Chaque déplacement, chaque geste, même le plus banal, devient l’occasion de susciter un torrent d’éloges et de commentaires admiratifs. Cette mécanique illustre une double logique : d’un côté, un besoin presque compulsif de reconnaissance, qui transforme l’ordinaire en événement ; de l’autre, une forme d’auto-illusion collective, où l’on célèbre l’apparence de l’action plutôt que son contenu.
Les somaliens, installés de longue date au cœur de l’appareil d’État, n’éprouvent nul besoin de cette amplification symbolique. Leur domination institutionnelle constitue, en elle-même, une reconnaissance permanente : leur pouvoir s’impose comme une évidence, sans qu’il soit nécessaire de le mettre en scène.
De cette asymétrie naît un double effet. D’un côté, la survalorisation de la rareté empêche toute remise en cause profonde des hiérarchies. De l’autre, la banalisation de la domination entretient un appétit insatiable de pouvoir. L’État tire profit de cette dialectique : il distribue l’exception aux uns pour acheter leur loyauté et satisfait l’exigence des autres en consolidant leur hégémonie.
Aussi longtemps que les Afars se satisferont de célébrer l’exception comme une conquête, l’État pourra reconduire la rareté comme mode de gouvernement. Et tant que les somaliens considéreront leur domination comme allant de soi, celle-ci se perpétuera dans l’indifférence générale. La politique djiboutienne se réduit alors à cette mécanique de gestion des perceptions : distribuer à petites doses la reconnaissance pour maintenir la loyauté des uns, normaliser la prépondérance pour entretenir l’assurance des autres. Autrement dit, l’État n’exerce pas seulement le pouvoir par les institutions, il le fait aussi par la manipulation des attentes et la fabrique de consentement.