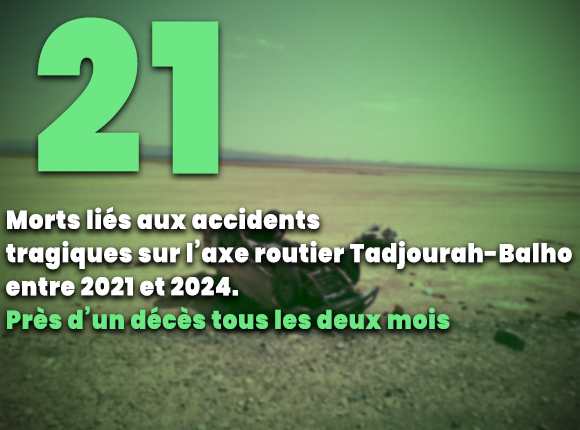Police Nationale
Une marginalisation structurelle et politique
À Djibouti, la question de la marginalisation des communautés – et plus particulièrement celle des Afars – ne peut être réduite à de simples dynamiques sociales ou économiques. Elle s’inscrit dans un système politique profondément inégalitaire, qui depuis plusieurs décennies, reproduit et renforce des pratiques excluantes à caractère tribaliste. Les Afars, peuple autochtone et pilier historique de la société djiboutienne, continuent d’être tenus à l’écart des sphères stratégiques du pouvoir, en dépit de leur poids démographique et de leur contribution à l’histoire du pays.
L’exclusion dont ils sont victimes n’est ni accidentelle ni circonstancielle. Elle relève d’un choix délibéré du pouvoir central, qui a institutionnalisé une politique de sous-représentation au sein des structures de décision. Le système politique actuel repose sur un déséquilibre volontaire qui marginalise certaines communautés au profit d’une élite ethnique dominante.
Un recrutement biaisé : le révélateur d’un système inégalitaire
En janvier, la Police nationale annonçait une grande campagne de recrutement pour former de nouveaux agents. L’événement, largement médiatisé et salué par une partie de l’opinion, visait à renforcer les effectifs au sein de la Police nationale. Pourtant, derrière l’euphorie officielle, les chiffres révélés ont provoqué la consternation : sur 350 jeunes sélectionnés, seuls trois sont d’ethnie afar.
Ce chiffre, scandaleusement bas, illustre la réalité d’un système sélectif fondé non pas sur le mérite ou l’équité, mais sur l’appartenance communautaire. Ce déséquilibre flagrant a suscité l’indignation au sein de la société djiboutienne, car il révèle une exclusion systémique déguisée sous les atours d’un processus administratif prétendument neutre.
Fin 2022, le cas particulier de discrimination subie par la lieutenante de police Oumma Ibrahim Mohamed avait émues la société djiboutienne. Lauréate de la formation d’Officier de Police Judiciaire (OPJ) en 2013, Oumma, seule Afar de sa promotion, est affectée à la brigade des mineurs du commissariat de Hodan. Alors que tous les officiers de sa promotion, bénéficieront d’avancement de grade, Oumma sera la seule à ne pas connaître d’évolution professionnelle. Cette injustice manifeste, perçue comme une sanction silencieuse, illustre les blocages systémiques auxquels font face les Afars au sein des institutions de l’État.
Un État arbitraire et partial
Il ne faut pas se méprendre : cette politique d’exclusion n’est ni le fruit d’erreurs ponctuelles, ni le symptôme d’un dysfonctionnement. Elle est le produit d’une stratégie planifiée, orchestrée depuis le sommet de l’État depuis 1977. Loin d’agir en arbitre neutre, le pouvoir central participe activement à l’invisibilisation des Afars, en verrouillant les cercles décisionnels et en verrouillant l’accès à toute ascension professionnelle.
Cette gestion communautariste du pouvoir empêche l’émergence d’une véritable représentation nationale. Elle privilégie la concentration du pouvoir entre les mains d’une élite issue d’une ethnie minoritaire, au détriment de toute idée d’équité ou d’unité. La République, dans ce contexte, est vidée de sa substance, trahie par une gouvernance qui institutionnalise la discrimination.
L’exclusion par l’invisibilité : le statut de « bras cassés », un outil de relégation silencieuse
Parmi les méthodes les plus sournoises utilisées par l’État pour neutraliser les Afars figure la pratique dite des « bras cassés ». Ce terme, désormais institutionnalisé, désigne des fonctionnaires à qui l’on n’attribue aucune tâche, aucune responsabilité, aucun rôle réel. Ces fonctionnaires, parfois des hauts cadres qui ont servi le pays avec abnégation, sont maintenus dans un état d’oisiveté forcée, perçoivent un salaire mais sont exclus de toute dynamique professionnelle.
Plus de 250 Afars sont aujourd’hui dans cette situation rien qu’à la primature, victimes d’un dispositif administratif qui, sous des apparences de normalité, cache un profond mépris. Il s’agit d’une stratégie de mise au placard collective, où ces employés deviennent invisibles, inutiles aux yeux de l’État, et socialement dévalorisés. Le « bras cassé » devient un fourre-tout humiliant, un levier de contrôle par la relégation, qui vide de sens le principe même de citoyenneté active.
Cette pratique, loin d’être anodine, sert un objectif clair : affaiblir psychologiquement une communauté entière, en lui refusant toute utilité et en la maintenant dans un état de dépendance stérile. Elle alimente un sentiment d’humiliation et d’aliénation, tout en détournant des compétences précieuses, sacrifiées sur l’autel du favoritisme ethnique.
Les conséquences d’un système tribaliste : une cohésion nationale en péril
La marginalisation des Afars n’est pas sans conséquences. Elle érode progressivement la cohésion nationale et menace la stabilité du pays à long terme. Lorsqu’une frange entière de la population est privée d’accès au pouvoir, aux opportunités économiques, à la reconnaissance sociale, le sentiment d’exclusion devient structurel. Il nourrit une défiance profonde à l’égard de l’État et peut, à terme, générer des formes de contestation plus radicales.
Les jeunes Afars, privés de perspectives, se retrouvent dans une impasse. Le désespoir engendré par cette politique discriminatoire les pousse à perdre confiance dans les institutions, voire à rejeter l’idée même d’un avenir commun au sein de la République djiboutienne.
Indignation collective : vers une prise de conscience ?
Pour la première fois depuis longtemps, des voix se sont élevées pour dénoncer publiquement la discrimination face à l’embauche constatée au sein de la Police nationale. La députée de la majorité Ouma Mohamed Hamid, tout comme l’ancien ministre de la Culture Rifki Abdoulkader, ont exprimé leur indignation face à l’ampleur de cette discrimination. Ces prises de position, bien que rares, témoignent d’un début de prise de conscience collective, dans une société longtemps anesthésiée par le clientélisme et le népotisme.
Mais cette indignation isolée ne suffit pas. Il est impératif que cette question soit portée dans le débat public, de manière libre et courageuse. Car tant que les logiques tribales continueront de dicter les politiques de l’État, tant que des communautés entières seront traitées comme des citoyens de seconde zone, la nation djiboutienne ne pourra aspirer ni à la justice, ni à la paix durable.