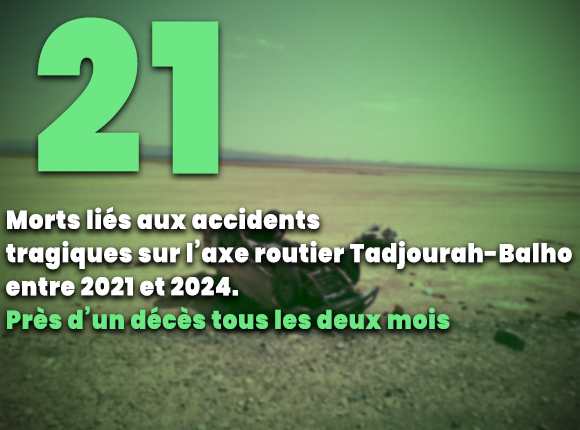Avec le soutien de la Banque africaine de développement, Ethiopian Airlines lance la construction du plus grand aéroport du continent. Une infrastructure colossale qui s’inscrit dans une stratégie plus large de développement et de rayonnement régional.
Pari audacieux pour l’Éthiopie. Alors que le pays sort lentement d’un cycle de conflits internes, son gouvernement multiplie les projets d’infrastructures pour relancer l’économie et renforcer sa stature régionale. Au cœur de cette stratégie, le secteur aérien – locomotive historique de l’économie éthiopienne – s’apprête à franchir un nouveau cap avec la construction du plus grand aéroport d’Afrique.

Bishoftu : le futur hub africain
Le 15 mars 2025, le ministère éthiopien des Finances a annoncé la signature d’une lettre d’intention entre Ethiopian Airlines et la Banque africaine de développement (BAD) pour la réalisation d’un nouvel aéroport international à Bishoftu, à une quarantaine de kilomètres au sud-est d’Addis-Abeba. Montant du projet : 7,8 milliards de dollars. Une somme colossale pour un pays dont le PIB tourne autour de 120 milliards, mais un investissement que les autorités estiment stratégique.
L’aéroport, conçu pour remplacer progressivement le hub actuel de Bole, devrait accueillir plus de 60 millions de passagers par an d’ici 2040 – contre 17 millions aujourd’hui – et pourrait, à terme, atteindre une capacité de 100 millions. Le chantier, mené avec l’appui du cabinet d’architecture Dar (basé à Dubaï), devrait s’achever d’ici cinq ans.
Ethiopian Airlines, fleuron continental
Avec 7 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 17,1 millions de passagers transportés en 2023-2024, Ethiopian Airlines s’impose comme la première compagnie aérienne du continent, loin devant ses concurrentes sud-africaines ou marocaines. S’appuyant sur un modèle intégré, mêlant fret, maintenance et formation, la compagnie a traversé la pandémie sans aide publique massive – une exception en Afrique.
Mais son hub principal, l’aéroport international de Bole, approche déjà de sa limite avec une capacité de 25 millions de passagers par an. Le projet de Bishoftu vise donc à accompagner la croissance continue de la compagnie, mais aussi à anticiper une montée en puissance du trafic aérien africain, encore largement sous-exploité.
Une ambition au-delà du ciel
Ce méga-aéroport ne se résume pas à un projet de transport. Il symbolise la volonté de l’Éthiopie de devenir un centre logistique majeur entre l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie. Avec la perte de son accès à la mer après l’indépendance de l’Érythrée en 1993, Addis-Abeba s’est tournée vers l’aérien et le rail pour compenser son enclavement. La ligne ferroviaire Addis-Abeba – Djibouti, rénovée avec l’aide de la Chine, et le développement d’un réseau de zones industrielles s’inscrivent dans cette même logique.
Ce nouvel aéroport pourrait ainsi devenir le pivot d’un écosystème logistique régional, attirant investisseurs, entreprises de fret, compagnies internationales, et contribuant à faire de l’Éthiopie un moteur économique de la Corne de l’Afrique.
Un projet ambitieux sous contraintes
Bien qu’il s’inscrive dans une vision stratégique claire, le projet de Bishoftu n’échappe pas aux interrogations. Le coût colossal de 7,8 milliards de dollars fait débat dans un pays qui peine à stabiliser son économie. L’inflation reste élevée, la dette publique frôle les seuils de vulnérabilité, et les tensions politiques internes – notamment dans les régions du Tigré, de l’Amhara ou de l’Oromia – continuent de fragiliser la stabilité nationale.
Si la lettre d’intention signée avec la Banque africaine de développement marque un soutien de principe, le montant précis de l’engagement financier de l’institution panafricaine n’a pas encore été rendu public. Le financement global du projet reste donc incertain et dépendra de la capacité d’Addis-Abeba à mobiliser d’autres bailleurs et partenaires privés.
En toile de fond, une question persiste : l’Éthiopie a-t-elle les moyens de ses ambitions ? Pour que ce méga-aéroport ne devienne pas un éléphant blanc, il faudra non seulement garantir les ressources financières, mais aussi préserver un climat politique propice à l’investissement et à l’intégration économique régionale.