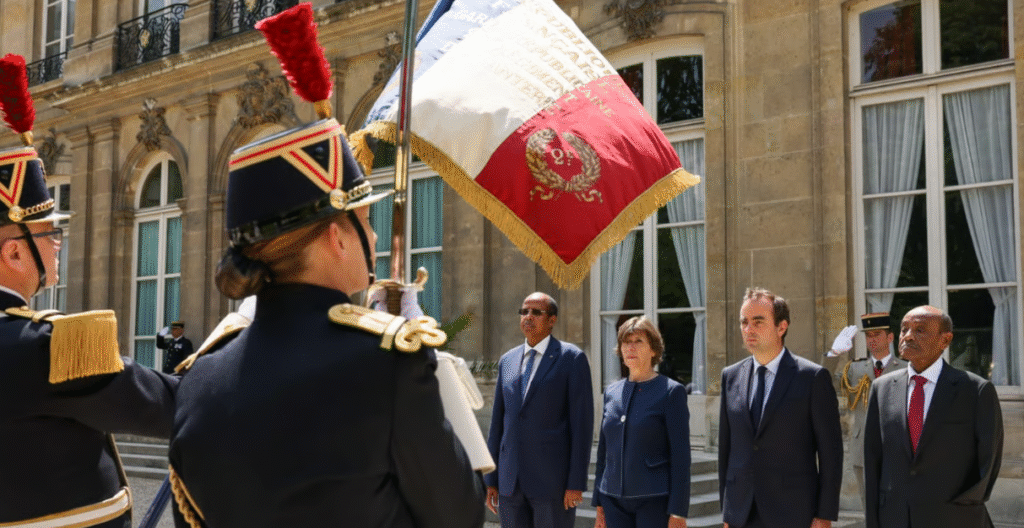
Le nouveau Traité de coopération en matière de défense (TCMD) entre la France et Djibouti a été adopté sans encombre. Le 23 juin 2025, l’Assemblée nationale française l’a adopté en première lecture à une large majorité — 92 % des 71 députés présents ont voté pour, certains députés se sont abstenus ou ont voté contre, sans pour autant faire dérailler le projet, entérinant un texte qui scelle pour vingt ans — renouvelables tacitement — la présence militaire française dans ce petit État de la Corne de l’Afrique. Moins d’une semaine plus tard, le 30 juin, l’Assemblée nationale de Djibouti ratifie à son tour le traité à l’unanimité, en séance plénière, à travers le projet de loi 175/AN/25/9e — sans le moindre débat public. Ce texte scelle pour vingt ans, renouvelables tacitement, la présence militaire française sur le territoire djiboutien.
Derrière ce double consensus parlementaire, un texte qui soulève pourtant de nombreuses interrogations : transparence budgétaire inexistante, clause de juridiction asymétrique, impunité renforcée pour les militaires français, et une participation française désormais formalisée dans la gestion de l’espace aérien djiboutien — alors même que ce dernier a été le théâtre d’une attaque meurtrière par drone en janvier dernier.
85 millions d’euros pour une coopération sans contrepartie
Le nouveau traité porte la contribution française annuelle de 30 à 85 millions d’euros. Ce triplement est présenté comme un appui au développement de Djibouti. Mais dans les faits, aucun mécanisme de contrôle parlementaire n’est prévu, aucun fléchage budgétaire n’est détaillé, aucun engagement sur les droits humains n’est exigé. Cette manne financière bénéficie à un régime classé parmi les plus autoritaires du continent, dirigé sans partage par Ismaïl Omar Guelleh depuis 1999.
Pour plusieurs observateurs, l’argent public français soutient ici un partenaire stratégique sans exigence de réciprocité démocratique — une constante des alliances avec des régimes dits illibéraux, c’est-à-dire des gouvernements élus mais autoritaires, où les libertés publiques sont bridées.

Ce jour-là, des drones turcs Bayraktar ont frappé un village de civils à la frontière éthiopienne, tuant une dizaine de personnes et en blessant au moins quinze autres. Selon les autorités, il s’agissait de « terroristes », formule floue qui renvoie souvent au FRUD-armé, groupe rebelle d’opposition djiboutien. Aucune enquête indépendante n’a été ouverte, aucune transparence sur l’éventuelle implication logistique française via la coordination aérienne.
Pour Mohamed Kadamy, président du FRUD réfugié en France depuis 1999, cette attaque pose une question majeure : la France était-elle informée, voire complice, de cette opération menée depuis un ciel qu’elle contribue à surveiller ? En février, le mouvement a saisi les autorités françaises et turques, sans réponse officielle à ce jour.
Un traité asymétrique et durable
Le traité ne se contente pas d’allouer des millions d’euros : il entérine une série de privilèges juridiques et fiscaux. L’article 17 prévoit une exonération fiscale totale pour les forces françaises, tandis que l’article 18 encadre une juridiction conjointe, dans laquelle la partie française conserve l’essentiel du contrôle. En cas d’infraction, les militaires français relèvent en priorité de la justice française, même pour des faits commis à Djibouti.
Quant à l’annexe I, elle garantit un accès permanent à plus de vingt sites militaires, sans restriction de durée. L’article 25 verrouille enfin le traité pour une durée de vingt ans, avec reconduction automatique, sauf dénonciation un an à l’avance — un délai qui rend toute révision politique pratiquement illusoire.
Françafrique 2.0 : un avant-poste consolidé
En validant à l’unanimité ce traité, les deux parlements ont consolidé un bastion stratégique dans une région sous haute tension. Alors que Paris est forcé de se retirer de plusieurs pays sahéliens, Djibouti devient l’exception : une base sûre, un partenaire sans exigence, un verrou maritime à proximité du détroit de Bab el-Mandeb.
Mais ce traité ne se limite pas à la sphère militaire — il offre à un régime autoritaire un blanc-seing diplomatique, un parapluie politique, et une rente durable, sans contrepartie démocratique ni débat citoyen.
Derrière les mots de « partenariat » et de « souveraineté partagée », se dessine une Françafrique 2.0 : plus discrète, plus technique, mais toujours fondée sur les mêmes logiques d’influence, d’impunité et d’intérêts militaires. Verrouillé pour vingt ans, ce traité prolonge l’ancrage français dans une région hautement stratégique — et confirme que, pour Paris, les droits des peuples passent après les priorités sécuritaires.




