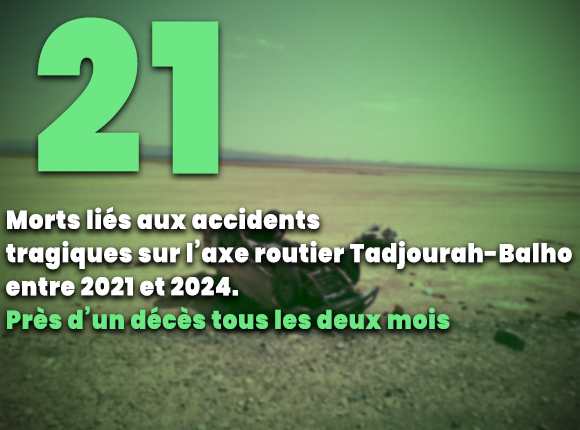Entre août 2021 et décembre 2023, la République de Djibouti a connu une série de violences intercommunautaires d’une brutalité rare, principalement dirigées contre la communauté Afar. Dans les quartiers périphériques de Djibouti-ville comme Warabaleh, PK12 ou Arhiba, ainsi que dans les régions intérieures (Tadjourah, Obock, Dikhil, Randa), des dizaines de morts, des centaines de blessés ont été recensés. Quatre ans plus tard, aucune enquête, aucune condamnation, aucun geste de réparation n’a été effectué. Les faits sont pourtant accablants.
Une répression étatique documentée
Le 1er et 2 août 2021, des affrontements entre jeunes Afars et un groupe de personnes armés et violents dégénèrent dans les quartiers de Warabaleh et PK12. Rapidement, les forces de l’ordre interviennent — non pour désamorcer les tensions, mais pour, selon des témoignages concordants, appuyer un camp. La Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) rapporte l’usage de balles réelles par la police, la destruction de plusieurs habitations, et l’arrestation arbitraire de dizaines de jeunes Afars.
À Tadjourah, les manifestations en soutien aux victimes de ces affrontements sont rapidement réprimées par l’armée, l’intervention tourne à la démonstration de force. Le ministre de la défense de l’époque, Hassan Omar, déclare publiquement : « Je regrette qu’il n’y ait pas eu de morts à Tadjourah », sans que cette phrase ne soit par la suite désavouée.
2022 : retour des violences, déni persistant
Au printemps 2022, une nouvelle flambée de violence éclate. Les mêmes quartiers sont ciblés. Des vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux montrent des policiers tirant à balles réelles sur des civils. Le quartier d’Arhiba, à majorité afar, est totalement bouclé. Le 28 mai 2022, la LDDH alerte une nouvelle fois : « Les vidéos mises en ligne prouvent, si nécessaire, la participation de la police, pour ne pas dire sa responsabilité directe. » Le bilan est d’au au moins quinze morts.
Un mois plus tard, la réalité de la torture apparaît au grand jour. Le 20 juin 2022, Saïd Ali Cheiko, un civil arrêté lors des événements de Warabaleh, meurt à l’hôpital Peltier. Diabétique, il avait été détenu sans soins, soumis à des traitements inhumains, jamais présenté à un juge.
Elle s’appelait Hasna. Elle avait un an. Morte asphyxiée après inhalation de gaz lacrymogène. Plusieurs témoignages confirment que les forces de l’ordre visaient délibérément l’intérieur des habitations. L’objectif ? Faire sortir les habitants de force, les livrer aux matraques, aux balles et à l’arbitraire. Une fois vides, les maisons étaient incendiées.

Décembre 2023 : une opération militaire au cœur de la capitale
L’épisode le plus brutal survient en décembre 2023. Dirigée par le colonel Abdourahman Ali Kahin, une opération policière d’envergure est menée à Warabaleh. Le quartier est bouclé, 45 maisons sont détruites. Le centre hospitalier local est pris pour cible : les forces de l’ordre y lancent des grenades lacrymogènes, provoquant des asphyxies parmi les blessés et les soignants.
La LDDH dénonce une attaque planifiée et systématique. Le 6 janvier 2024, loin d’un désaveu, le ministre de l’Intérieur, Said Nouh, félicite le colonel Kahin pour « sa détermination » et celle de ses équipes. Aucune allusion n’est faite aux victimes.
Origines régionales : une guerre aux racines territoriales
Au-delà des frontières djiboutiennes, ces violences s’inscrivent dans un contexte régional tendu. Dans la région frontalière entre les zones afars et somali d’Éthiopie, les affrontements entre milices se multiplient. Les revendications territoriales de certains groupes somalis-issas, accusés de vouloir annexer des terres afars, exacerbent les tensions.
Selon plusieurs rapports, l’État djiboutien aurait activement soutenu ces milices. Des armes identifiées comme provenant des stocks officiels djiboutiens auraient été saisies dans des camps somalis-issas. Des drones offerts par le Japon aux garde-côtes djiboutiens auraient également été détournés. La présence sur le terrain d’anciens cadres militaires, tel que le commandant Abdi — ex-officier de l’AMISOM arrêté dans la région de Yangudi — renforce les soupçons d’une implication directe du régime dans ces opérations transfrontalières.

Le silence comme stratégie d’État
Malgré la gravité des faits, les autorités djiboutiennes restent muettes. Aucune reconnaissance des violences, aucun geste de réparation, et surtout, aucune procédure judiciaire n’a été engagée. Les plaintes des familles, relayées par les organisations de défense des droits humains, restent lettre morte. La LDDH cite plusieurs hauts responsables sécuritaires, notamment le colonel Abdillahi Abdi, ancien chef de la police, qui aurait personnellement dirigé certaines opérations à Warabaleh.
Sur place, les stigmates des violences sont encore visibles. Murs calcinés, toitures effondrées, habitations désertées. Les familles endeuillées n’ont reçu ni visite, ni indemnisation. Pour les Afars de Djibouti, la peur s’est installée durablement.
Une fracture nationale qui s’élargit
À Warabaleh, les murs calcinés et les toitures éventrées sont toujours là. Les familles endeuillées n’ont jamais été approchées par un représentant de l’État. Leur douleur, niée, s’est transformée en colère sourde. Une fracture ethnique béante divise désormais la société djiboutienne. Le pouvoir, en refusant la justice, alimente délibérément la polarisation.
À Djibouti, être Afar, c’est aujourd’hui vivre dans la peur. Une peur que l’État a installée, légitimée, institutionnalisée.
En l’absence de réponse étatique, une fracture ethnique profonde semble s’installer. Le refus d’ouvrir un débat national sur ces événements, de reconnaître les souffrances infligées à une partie de la population, alimente un ressentiment croissant. À Djibouti, être Afar signifie aujourd’hui vivre dans une insécurité permanente, marginalisé par un pouvoir sourd à leurs revendications.
Dans un pays souvent présenté comme un îlot de stabilité stratégique dans la Corne de l’Afrique, cette politique du silence n’est pas sans conséquences. À mesure que l’oubli s’institutionnalise, la défiance grandit. Et avec elle, le risque d’une crise politique plus large.